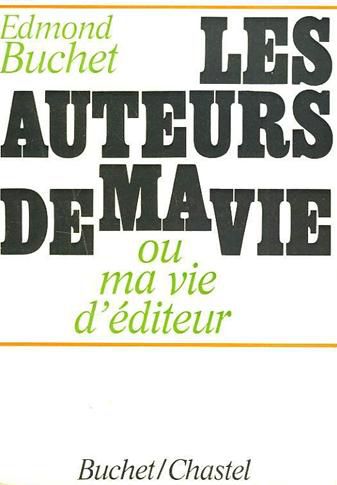DEBORD
Edmond Buchet, Les auteurs de ma vie, Buchet-Chastel, 1969
C’est le journal d’un éditeur. Mais ce n’est pas n’importe quel éditeur. Il s’est trouvé dans les années cinquante et soixante à la pointe de la modernité littéraire de l’époque, publiant Henry Miller, Lawrence Durrel, Roger Vailland ou encore Malcolm Lowry. C’est-à-dire une forme de littérature moderne, mais fort éloignée des errements du Nouveau Roman. En même temps qu’on pénètre les arcanes d’un milieu bien compliqué, avec ses magouilles pour les prix, ses coups fourrés pour retenir ou piquer un auteur la concurrence, on entrevoie la façon dont les éditeurs forment leurs goûts et choisissent les ouvrages à publier. Et bien sûr on est frappé par ce décalage qu’il peut y avoir entre le mode de vie d’un écrivain qui travaille à ses manuscrits et celui de son éditeur qui passe son temps dans les cocktails et les rendez-vous mondains. Les pages de Buchet sur Roger Vailland sont très émouvantes cependant.
Et puis Buchet publia les romans de Michèle Bernstein et celle-ci lui amena Guy Debord et La société du spectacle. Les passages qui concernent les deux situationnistes sont assez intéressants, peut-être plus pour ce qui concerne Michèle Bernstein. La légende voudrait que Tous les chevaux du roi et La nuit ne soient que des sortes d’œuvres de circonstance, juste produites pour renflouer les caisses de l’IS, mais sans conviction littéraire. Le récit de Buchet montre qu’il n’en est rien et que Michèle Bernstein envisageait même de continuer sa carrière littéraire au-delà de ces deux ouvrages. Mais on ne sait pas plus pourquoi cela ne se fit pas, et ce d’autant qu’assez rapidement Michèle Bernstein d’éloigna de l’IS et de ses exigences quant à l’obligation de se tenir à l’écart des formes littéraires bourgeoises et du cirque médiatique qui les accompagne. Buchet fait du reste le rapprochement efficace entre Tous les chevaux du roi et la « morale » anticonformiste que développait Roger Vailland à la même époque.
On remarque au passage que Buchet refusa de publier Vaneigem, passant donc à côté d’une bonne affaire au final, mais surtout qu’il le refusa pour des défauts d’écriture et de présentation. En revanche, il loue les qualités de rigueur dans l’écriture de Guy Debord. On voit que dès avant que les situationnistes ne deviennent connus, le jugement littéraire est déjà fait : Vaneigem n’a pas le talent ni la rigueur de Debord. C’est bien sûr le jugement d’un éditeur bourgeois, mais le temps va le confirmer. Même si aujourd’hui Vaneigem a toujours un peu de succès, il n’a jamais atteint et n’atteindra jamais cette reconnaissance de l’establishment littéraire à laquelle Debord a finalement pu prétendre avant les événements de mai 68.
Extraits de Les auteurs de ma vie :
10 juillet 1960
Tous les chevaux du Roi de Michèle Bernstein, dont le mari, Guy Debord, dirige l’internationale situationniste, exprime peut-être plus de pudeur que de cynisme. « S’aimer assez pour se laisser libre », est une morale qui est celle de Vailland et de beaucoup de jeunes, plus admirable assurément que celle qui protège une possession exclusive, mais dont l’application n’est pas toujours facile. La peur des grands sentiments ou de leur expression, la volonté d’afficher une liberté absolue, la volonté d’être affranchi n’empêche pas une pointe de souffrance de sourdre et de cheminer sous le masque. Cette présence palpitante comme un oiseau blessé prend d’autant plus de réalité qu’elle ne se laisse pas étouffer.
Je pense au film des Tricheurs. Dans Tristan, la convention qui brimait l’amour restait extérieure; c’était le roi Mark, l’idée du mariage, l’idée religieuse, le respect de la parole donnée, de la forme contre l’esprit, de la parole contre le sentiment. Dans Les Tricheurs, l’obstacle vient de l’attitude cynique, ou plutôt de l’obligation de liberté sexuelle absolue. Dans Tristan, il faut être fidèle; dans Les Tricheurs, il est interdit d’être fidèle. Dans un cas comme dans l’autre, il n’existe pas de vraie liberté.
Il semble aussi que la pudeur des sentiments aille de pair avec l’impudeur des gestes, réaction naturelle contre le romantisme qui prônait exactement le contraire. Le sentiment gonflé a tué le sentiment vrai, tout comme le cynisme trop affiché est en train de tuer le cynisme authentique. Lorsqu’il ne scandalisera plus, il n’aura plus de raison d’être. Peut-être alors, enfin, deviendra-t-on naturel.
9 septembre 1960
Interview insolite de Michèle Bernstein par Pierre Dumayet à la TV. Il est d’usage de préparer l’interview, de ne pas l’apprendre par cœur certes, mais de convenir du plan, des questions et des réponses. Or, notre Michèle, dont l’apparition sur l’écran, avec son air de jeune garçon frondeur était déjà insolite, ne respecta pas le moins du monde cette convention. Elle s’échappa, se rebiffa, attaqua, avec autant d’esprit que d’agressivité et Dumayet, arroseur arrosé, bourreau torturé, ne sachant plus que répondre, finit par interrompre brusquement l’interview.
Le lendemain, encore furieux, il me téléphona, m’adjurant de ne plus lui envoyer des auteurs de cet acabit. J’ai trouvé au contraire cette interview inattendue et véritablement improvisée plus vivante que les autres et je suis certain que les téléspectateurs auront ressenti une secrète satisfaction à voir, pour une fois, le toréador estoqué par le taureau, et cela d’autant plus que ce dernier apparaissait sous la frêle apparence d’une jeune femme.
1er septembre 1961
Très content du nouveau roman de Michèle Bernstein : La Nuit. Je ne m’étais donc pas trompé en prenant Tous les Chevaux du Roi —, malgré l’apparence de pastiche. La Nuit commence aussi par une sorte de pastiche, de Robbe-Grillet, cette fois, non de Sagan, mais ce n’est encore une fois qu’une apparence. Non seulement Michèle B. diffère de Robbe-Grillet par sa sensibilité essentiellement féminine, mais elle tente une expérience beaucoup plus vaste. Mélangeant le passé, le présent et le futur, elle envisage les personnages, qui sont les mêmes que ceux de son premier roman, sub specie aeternitatis. Ainsi leur destin tout entier forme un bloc d’apparence immobile, au sein duquel se produisent des mouvements divers. Elle n’est certes pas la première à mêler le passé et l’avenir, mais il ne s’agit plus de flash backs, comme chez Faulkner ou Claude Simon, mais bien d’une unité nouvelle, espace-temps, que l’on pourrait considérer, à plus justes raisons que chez Durrell, comme einsteinienne. Je ne sais si Michèle B. a eu cette intention. Bien que sa création soit assez volontaire, j’espère que non. Je crois en effet que le véritable génie créateur peut engendrer des théories, mais qu’il est rarement engendré par elles. L’art de Michèle B. apparaît encore comme un exercice. « Maintenant, vous avez fait vos gammes », lui ai-je dit. Elle pense qu’elle sera totalement elle-même dans son prochain roman. Elle me le promet.
22 août 1967
Michèle Bernstein vient de m’apporter un manuscrit très remarquable sous l’angle de l’intelligence et de la rigueur de son mari Guy Debord. Ces situationnistes ont une pureté que j’admire, une pureté et une intransigeance qui les brouillent avec tout le monde et d’abord, bien entendu, avec les communistes. On a pu croire un moment qu’ils formaient l’intelligentsia des provos d’Amsterdam et ils se sont employés en effet à jeter de l’huile sur le feu, mais ils ont rompu avec eux. « Ils sont vraiment trop bêtes », me dit Michèle.
C’est elle qui fait le truchement entre les situationnistes et moi. Elle m’avait apporté il y a quelque temps un manuscrit de Vaneigem intitulé Petit Manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Nous ne l’avions pas retenu, l’ayant trouvé intéressant mais préconisant des solutions par trop naïves. Celui de Guy Debord a beaucoup plus de rigueur tant dans l’écriture que dans la critique implacable de notre société de consommation. Je lui demande toutefois de changer le titre, beaucoup moins public que celui de Vaneigem. La Société du Spectacle prête à confusion. Les acheteurs éventuels, qui, dans leur plus grande partie, ignorent tout du situationnisme vont croire qu’il s’agit d’un livre sur le théâtre. Mais Debord est aussi entêté que Robespierre et Saint-Just additionnés. Il ne veut pas changer son titre et je sens qu’il n’y a rien à faire pour le persuader. Il m’avertit d’avance qu’il ne veut pas qu’on publie sa photo, qu’il ne se prêtera à aucune interview et qu’il refusera la TV. La publicité promet d’être délicate.
J’estime beaucoup le livre, mais je pense qu’il s’agit essentiellement de théorie et de spéculations intellectuelles. Michèle Bernstein me détrompe et m’assure que nous verrons prochainement de grands bouleversements dans plusieurs pays d’Europe et en France même. Ils ne doutent pas que l’avenir ne soit à eux.
Eric Brun, Guy Debord et l’Internationale situationniste, décembre 2011 (suite et fin)
La première partie de ma critique peut paraître un petit peu sévère, parce que tout de même Brun a beaucoup travaillé, il a beaucoup lu. Mais elle me paraît nécessaire parce que finalement on amasse beaucoup de connaissance sur Guy Debord, sans le plus souvent savoir quoi en faire. On peut certes juger que Debord s’est beaucoup trompé – à moins de faire l’âne comme Kaufmann, Zagdanski et les autres thuriféraires. Et de fait on peut, dans une logique d’enquête policière, accumuler les « preuves » qu’il s’est beaucoup trompé et que sa pensée s’est plus souvent qu’à son tour trouvée dans le sillage d’autres penseurs et philosophes dont il est resté tributaire.
Ce n’est pas cela qui a mon avis est important, car en matière d’action politique et de révolution tout le monde se trompe tout le temps… ou presque. Recenser les erreurs théoriques et pratiques de Debord est certes intéressant, puisque cela fait redescendre le grand homme du piédestal où on l’a abusivement installé, mais cela ne dit rien de plus. Or ce qu’oublie Brun c’est que si la « gloire » de Debord perdure près de deux décennies après sa disparition, c’est aussi qu’il nous parle de la nécessité de combattre pour la liberté et pour notre émancipation, pour changer le monde dans un sens un peu positif.
Le véritable sujet d’une analyse de la trajectoire de Debord devrait être, à mon avis, l’étude de cette marge étroite qui s’offre à nos possibilités matérielles d’agir sur le monde plutôt que d’être agi par lui. Debord lui-même rendra compte de son échec en se retirant progressivement du champ de bataille, se transformant peu à peu en un simple écrivain. Il s’est notamment cassé les dents sur la question de l’organisation, voulant à la fois maintenir les deux termes d’un combat douteux où se mêlent à la fois la volonté de vivre « en dehors » des normes imposées et de combattre la société bourgeoise sur son terrain en croyant produire pour l’avenir des nouvelles normes dans la vie quotidienne. C’est pourquoi ramener le combat de Debord et de l’IS a de simples considérations sociologiques, la trajectoire singulière des individus dans la société, apparaît insuffisant et fini par ne rien expliquer du tout.
Debord cherche toute sa vie, ou du moins jusque dans les années quatre-vingts la formule pour trouver la jonction entre les mouvements d’avant-garde et les masses pour agir à la transformation du monde. Mais sa manière de s’insérer dans ce combat – la société ne pouvant changer radicalement sans leur participation – est chaque fois vouée à l’échec et chaque fois la cause de très grandes déceptions. Parmi les multiples raisons de cet échec il y en a au moins deux qui méritent attention : la première est le fait que Debord et l’IS justement ont un mode de vie qui est coupé des masses : ils refusent le travail, du moins s’y essayent-ils de façon a donné toute leur énergie à une révolution dans la culture. La clé de cette position erronée se trouve dans l’idée proposée par l’IL et qui fera le fonds de commerce de l’IS selon laquelle la révolution dans les superstructures précèdent la révolution dans la société. « Ce que l’on appelle culture reflète, mais aussi préfigure, dans une société donnée, les possibilités d’organisation de la vie » écrit Debord dans son Rapport sur la construction des situations.
La seconde, mais c’en est le corollaire, est qu’ils ne comprennent pas le positionnement des prolétaires vis-à-vis de l’art comme système de représentation de leurs aspirations. Par exemple le refus de la littérature prolétarienne comme référence est tout à fait symptomatique, ils la confondent avec une simple reproduction d’une forme dégradée de la culture bourgeoise. Debord entrevoit ce problème justement en critiquant l’avant-gardisme dans la sphère artistique qui se fonde sur un combat « pour la forme ».
La thèse oscille entre une analyse historique – retracer la formation et la transformation de l’IS – et une analyse sociologique – qui sont ceux qui ont fait l’IS, d’où venaient-ils. C’est même assez curieux que sa directrice de recherche ne l’ait pas remarqué. Pour cette raison elle est insatisfaisante. Par exemple rien n’est dit sur les rapports qu’il peut-y avoir entre la lutte contre l’Allemagne nazie et la formation d’une pensée révolutionnaire. Or c’est décisif, parce que c’est justement l’implication du Parti communiste (des partis communistes même) qui explique leur hégémonie intellectuelle sur la gauche révolutionnaire. la Résistance est un modèle de combat pour changer le monde. Brun passe ainsi très vite sur le fait que les compagnons de Guy Debord sont presque tous issus de la mouvance communiste, Jorn, Mension, Dotremont, Constant, Wolman, Chtcheglov, etc. Il ne dite même pas que Jorn a été impliqué – on ne sait à quel degré d’ailleurs – dans la résistance danoise. Il avalise ainsi une coupure qui n’a pas lieu d’être. C’est bien pour cette raison d’ailleurs que Debord se sent dans un premier temps plus proche des surréalistes belges qui sont ouvertement communistes, staliniens aussi dans le sens provocateur, que de Breton qui pendant l’Occupation s’est exilé en Amérique. Sur ce terrain les confusions de Brun sont très nombreuses, par exemple il suppose que Sartre qui a eu tant d’importance dans la formation intellectuelle de Debord, a été résistant ce qui n’est absolument pas le cas. Il l’amalgame bizarrement à Camus, qui lui venait du peuple, et qui a été un vrai résistant.
Au final ce qu’il manque à la thèse de Brun, sans parler du style, c’est d’être justement une thèse !!
HERVE FALCOU ET L'AVANT-GARDE
H. Falcou qui fut le condisciple de Debord au lycée Carnot de Cannes écrivit un article sur l'avant-garde dans lequel il parlait entre autres choses de l'IS. Ce qui ne plut pas vraiment à Debord. Voilà cet article.
Aux yeux de l’histoire
On a lu Sade, Hitler, le Zen et le pseudo-Mao.
Il y a du courage à écrire sur les revues en marge, à tirage restreint (encore que l’édition en soit souvent luxueuse) et peu lues. Non seulement à cause de leur abondance : l’amateur de dévastation, d’a-littérature et d’humour convulsif serait péniblement surpris de savoir quels trésors il néglige chaque moi faute d’initiation. Mais surtout à cause de l’extrême férocité de leurs rédacteurs, qui promettent invariablement aux critiques naturellement imbéciles et malhonnêtes (le plus souvent les deux à la fois) de leur faire la peau ou pis, de les déchirer intellectuellement pour l’éternité au prochain numéro.
Une considération seulement m’a décidé à hasarder ma vie et à affronter le ridicule de la postérité : ce que les revues haïssent le plus, c’est le silence, sous la forme de la célèbre conspiration. Car il est clair que la lecture à radio-Luxembourg d’un fragment du « Tombeau de Pierre Larousse » de François Dufrène (ultra-lettriste, Revue – Grâmmes) :
HORBI etturBi – Jojé titurBI ;
VALerilarBO – VALerilarBI.
VALôris BOléröleyRIS LOuLEY ;
Lörel ôzIOL etarDI !
ferait croûler les murailles de Jéricho.
Encore est-il de mon devoir d’attirer l’attention du profane sur l’expressionisme facile d’un tel texte. L’ultra-lettrisme se compromet gravement avec le sens et flirte avec le calembour culturel.
Moins frelatée apparaît la revue lettriste tout court (qui compte encore en son sein Isidore Isou), ce dont témoigne le sonnet des voyelles de Jean-Louis Brau :
a
e
e
a
i
o
o
i
u
u
y
y
u
u
On conçoit que des textes aussi percutants puissent terroriser, pour peu qu’audience leur soit donnée, le monde des arts et des lettres et faire courir les plus graves périls à l’organisation sociale de l’Ouest et de l’Est.
Les cosmonautes
C’est aussi le redoutable programme des « Lèvres nues », revue qui fut l’ébauche un peu timide, il est vrai, de « L’Internationale Situationniste » : « Par « révolution mondiale », il faut comprendre ici, très exactement, le renversement du capitalisme dans tous les pays du monde où ce renversement n’est pas accompli… Par « immédiate », il faut entendre que le programme que nous allons exposer s’inscrit dans une période fixée à un an ; délai approximatif au-delà duquel il serait oiseux d’escompter sa réussite, celle-ci étant obligatoirement tributaire d’une action intense et rapide ». (Théorie de la révolution mondiale immédiate).
Mais dans « L’internationale situationniste » je relève d’autre part ce propos de Uwe Jansen[1] : « Les situationnistes ne sont pas cosmopolites. Ils sont des « cosmonautes ». Ils osent se lancer dans des espaces inconnus, pour y construire des îlots habitables pour des hommes non-réduits et irréductibles ».
Bravo. A lire ces revues, le profane pour qui j’écris ces lignes pourrait croire que d’inexpiables querelles les opposent, ou s’attendre à voir clairement paraître entre elles des abîmes d’oppositions théoriques ; et plus modestement de notables différences d’intérêt. Point. C’est morne[2], les excommunications se font sur des vétilles et les haines sont d’autant plus ardentes que les différences sont moindres.
Bref à l’intelligence et au talent près des collaborateurs, il est aisé de faire un petit inventaire des attitudes « basiques » des revues ex-maudites :
1. Chaque revue est consciente de son infaillibilité au point que les prétentions de Pie IX lui-même apparaissent comme des jeux d’enfant arriéré ;
2. L’humanité est divisée en deux catégories : les adeptes et les réfractaires (raisons diverses, mais également déshonorantes). Les adeptes risquent l’exclusion. Mais pour les réfractaires, ce sera la fête, un jour ou l’autre et selon ttoutes les modalités imaginables. (On alu Sade, Hitler et le pseudo-Mao Tsé-toung).
3. le manque d’audience d’une publication est le critère absolu de sa génialité. Il est même étrange et à mon sens défaitiste que certaines publications aient recours aux services de talents éprouvés comme celui de Magritte. Cette proposition sommaire repose d’ailleurs sur une argumentation historique implicite certes, mais non dépourvue d’efficacité : le comte de Nieuwerkerke a déclaré que la peinture de Courbet était le fait d’un dégoûtant sauvage. Et qui a eu l’air fin aux « yeux de l’Histoire » ? C.Q.F.D.
4. Contrairement à ce que pensait Marx, l’ignorance est presque toujours une qualité : elle permet au moins d’être neuf, en dépit du Zen, de Jarry, de Dada et du surréalisme.
La belle Hélène
5. La littérature, la philosophie, la mathématique et plus généralement tous les arts et toutes les sciences, humaines ou non, se résument, sauf à n’être rien, dans la poésie. Sur la définition de celle-ci, il faut avouer que les doctrines différent essentiellement :
a) des groupuscules attardés au langage prétendent couler les explosions galactiques de la liberté absolue et de la surréalité scientifique dans des formes poétiques auxquelles ils croient encore.
Nous fuyons les néons
Les banlieues de bidon
Aux vapeurs malsaines
Nous partons chercher la belle Hélène
Au fond des bordels
(Le Taureau)
Il est clair que ces messieurs n’ont qu’une idée livresque de l’amour vénal.
b) la masse de l’avant-garde, quoique cruellement divisée, a reconnu que la poésie, comme forme d’art, était morte (je ne fais pas d’allusion désobligeante à des textes antérieurs). Mais elle reste une valeur à réaliser dans diverses manifestations qui expriment seules son essence vraie : la page vierge ; le scandale ; à la rigueur l’expression vocalique ou consonantique – qui peut-être le prétexte de fâcheuses compromissions.
6. L’humour, vert par exemple, compte parmi les moyens privilégiés de la subversion. Mais ceux qui se défient de l’humour – les situationnistes par exemple – prodiguent pourtant le meilleur :
« Au mois d’octobre 1962, le dernier concile catholique a commencé à Rome. »
Pour les autres, l’application humoristique conduit à de rigoureux recueils où l’ennui mortel est de règle – pour le profane évidemment. Ainsi lisant « Phantomas » j’ai songé à cette dame de « L’assommoir » qui faisait sans cesse des plaisanteries obscènes si subtiles qu’elle seule s’en régalait. Et j’ai sangloté de ne pas être dans le coup.
7. La subversion poétique et humoristique étant totale et totalement en avance sur le siècle, elle en néglige évidemment les querelles contingentes. Les scissiparités du lettrisme par exemple éclipsant comme le soleil dans sa gloire le fait de l’ombre, tous les événements mineurs : guerre d’Algérie et le Référendum, crise de Cuba et coexistence, etc.
8. Toutes les formes d’expression étant foutues et celle-là même dépendant d’une société également foutue et abominable, il urge de changer la dernière au profit des premières. Il semble que dans un nombre de cas on fasse confiance au verbe, ou plus terriblement à l’absence de verbe. Tremble qui pourra : la menace est grave.
9. Un appétit absolu – quoique férocement caché – de succès, rend dérisoires tous les moyens de sa réalisation. Toutes les presses et toutes les radios mobilisées ne suffiraient pas à vociférer ce silence. Souhaitons qu’il soit un jour entendu.
Mais pour ce faire, je rappellerai aux maudits en mal de triomphe impérial ces abominables paroles de Baudelaire : « Oui, monsieur, les temps sont mauvais et corrompus ; mais la bonne philosophie en profite sournoisement pour courir sus à l’occasion, et ne perd pas son temps aux anathèmes. »
Hervé Falcou
Ce texte appelle de nombreux commentaires. Le premier est qu’il explique au fond pourquoi Falcou n’a pas poursuivi sa fréquentation des avant-gardes. Les critiques qu’il lui adresse sont celles qu’on peut adresser à tous les mouvements d’avant-garde depuis au moins l’apparition du mouvement surréaliste. Non seulement elle est coupée des masses et de la réalité – c’est bien aussi cette critique que la Parti communiste adresse à Breton et aux siens – mais sa prétention à subvertir l’ordre bourgeois par l’activité poétique au sens large prête à rire. Cette position de Falcou est d’autant mieux à sa place en 1963, qu’elle s’inscrit dans une France qui se transforme positivement sur le plan économique et qui accède à la société de consommation. Le pessimisme d’avant-garde apparaît alors en décalage avec la réalité. Le second commentaire est que Falcou ménage l’Internationale situationniste : il leur accorde que parmi les avant-gardes, ils sont plus originaux que les débris du mouvement lettriste dont il ridiculise la volonté de révolutionner la poésie – mais au passage Falcou approuve le fait que la poésie n’est plus un moyen d’expression à envisager.
Pourtant cette relative bienveillance de Falcou vis-à-vis du mouvement de Guy Debord ne va pas ravir ce dernier, bien au contraire, il en prend ombrage. Il est vrai que la façon dont Falcou se moque de Uwe Lausen qu’il transforme en Uwe Lansen, est assez facile. Dans une lettre à Vaneigem, datée du 1er avril 1963, il écrit : « A propos de l’Express, il est tout à fait exclu de répondre dans l’actualité, pour diverses raisons dont René pourra t’exposer quelques-unes (j’ai connu il y a longtemps ce Falcou). Nous trouvons, bon an, mal an, que ce genre de citation est un bon signe (le moment où les « spécialistes » commencent à vouloir valoriser leur spécialisation même de critiques modernes en montrant qu’ils connaissent ce qu’ils ont d’abord caché), et même sans doute publicitairement positif. Bien sûr, il est tout de même bon d’écrire un texte sur les « témoins de leur temps », mais pour le sortir avec du recul. Traitant alors ce thème « de quelle façon dérisoire est apparue l’I.S. dans la critique culturelle spécialisée – par rapport à tout ce qu’il y avait à en dire. »
Comme on le voit au ton de la lettre, c’est la déception qui domine, même si elle renvoie Falcou à un rôle de critique spécialisé. Debord sait très bien à quoi s’en tenir avec lui. « ce Falcou » le dérange essentiellement parce qu’il ne partage plus son programme subversif, ce qui introduit naturellement le doute sur sa poursuite et ses chances de succès.